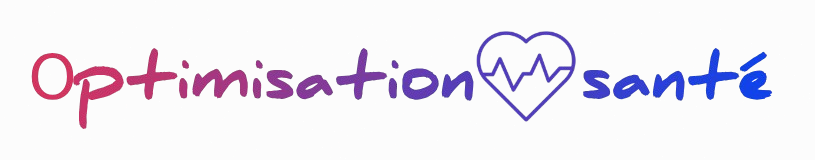La “drunkorexie” n’est pas un simple buzzword. C’est un comportement à risque où l’on saute des repas pour “économiser” des calories et pouvoir boire davantage d’alcool.
À la croisée des troubles du comportement alimentaire et de la consommation excessive, elle touche surtout les jeunes adultes. Aujourd’hui, nous allons l’expliquer simplement, détailler ses risques et surtout proposer des pistes concrètes pour agir.
Ce sujet nous concerne tous. Que l’on soit étudiant·e, parent, ami·e ou professionnel·le de santé, comprendre la drunkorexie aide à mieux protéger notre santé physique et notre équilibre émotionnel. Et si l’on apprenait à faire la fête sans sacrifier notre corps ni notre stabilité ?
Qu’est-ce que la drunkorexie ? Définition claire
Origine du terme et comportements associés
Le mot naît de la contraction de “drunk” (ivre) et “anorexie”. Il désigne des comportements où l’alcool prend la place des repas, parfois accompagné d’un exercice intense pour “compenser”. L’objectif affiché est souvent de limiter l’apport calorique total, tout en maintenant une vie festive.
En pratique, ce comportement peut ressembler à un déjeuner zappé “parce que ce soir on sort”, ou à un dîner ultra léger suivi de plusieurs verres. Ce n’est pas un caprice ponctuel : répété, ce pattern fragilise le corps et l’esprit, et entretient un cercle vicieux entre image corporelle et consommation d’alcool.
Pourquoi il faut prendre ça au sérieux
Remplacer des nutriments par de l’alcool, c’est priver l’organisme d’énergie stable, de vitamines et de minéraux. L’alcool apporte des calories “vides” qui ne nourrissent pas les muscles, le cerveau ni le système immunitaire. Résultat : fatigue, troubles de la concentration, irritabilité et fringales désordonnées.
Au-delà de la nutrition, la drunkorexie s’inscrit souvent dans une relation complexe au poids, à l’apparence et à la pression sociale. C’est pourquoi aborder le sujet avec bienveillance et sérieux est indispensable.
Qui est concerné ? Pourquoi les campus sont particulièrement exposés
Jeunes adultes et étudiantes en première ligne
La drunkorexie apparaît surtout chez les jeunes, en particulier chez les étudiantes. Les soirées, la vie en colocation, les rites d’intégration et la volonté de “tenir la cadence” créent un terrain propice. À cela s’ajoute la pression pour “rester mince” malgré une vie sociale animée.
Cette double injonction — être festive et “fit” — nourrit des arbitrages malsains : on sacrifie des repas pour “gérer” les calories des verres, sans voir que l’on augmente les risques pour sa santé.
Normes sociales et culture de l’alcool
Sur beaucoup de campus, “tenir l’alcool” est valorisé. Les jeux, les tournées et les promotions rendent la modération difficile. Les réseaux sociaux amplifient ces codes en exposant des images idéalisées de soirées “parfaites” et de corps “irréprochables”.
| Boisson | Calories approximatives |
|---|---|
| Verre de vin | ~120 kcal |
| Bière 25 cl | ~110 kcal |
| Cocktail sucré | 200–300 kcal |
Sauter un repas n’efface pas ces apports. Au contraire, boire à jeun augmente l’ivresse et les risques d’accidents.
Le rôle des publicités et du marketing
Certaines communications ciblent explicitement les jeunes femmes avec des boissons “légères” ou “détox”, suggérant qu’on peut boire sans “payer” sur la balance. C’est un mirage publicitaire. L’effet est pernicieux : il normalise un calcul calorique anxieux autour de l’alcool.
Les risques : comment le corps et l’esprit encaissent
Carences, hypoglycémie et organes sous tension
- Boire à jeun entraîne des pics d’alcoolémie rapides : le foie travaille en urgence et le cœur peut s’emballer.
- Des carences en protéines, fer, vitamines B et magnésium s’installent : fatigue chronique, chute de performance et troubles cognitifs.
- L’hypoglycémie accroît la désorientation, les nausées et le risque de malaise ; elle favorise des prises alimentaires impulsives et le yo-yo.
Santé mentale : anxiété, dépression et isolement
La drunkorexie est souvent associée à l’anxiété, à la dépression et à une estime de soi fragile. L’alcool, utilisé comme régulateur social ou émotionnel, intensifie ces symptômes à moyen terme. On s’enferme dans un cycle où l’alcool apaise sur le moment, mais aggrave l’humeur ensuite.
Ce cocktail fragilise aussi les relations : on évite les repas entre ami·e·s, on cache ses habitudes, on se met en danger en soirée. La honte et le secret freinent la demande d’aide, alors que le soutien est déterminant.
Accidents et conduites à risque
L’ivresse à jeun augmente les chutes, les blackouts et les comportements impulsifs. La capacité de jugement baisse rapidement, avec des conséquences immédiates sur la sécurité routière, les blessures et les violences subies ou commises. Ici, la prévention est une priorité de santé publique.
Prévenir et accompagner : gestes simples et dispositifs concrets
Éducation et littératie nutritionnelle
Comprendre ce que mangent le cerveau et les muscles aide à faire de meilleurs choix. Un repas équilibré avant de sortir, une bonne hydratation et une collation salée au retour changent tout. Mon astuce préférée : décider à l’avance de l’heure du dernier verre et préparer un petit-déjeuner pour le lendemain.
➡️ À retenir : boire et manger ne sont pas des options interchangeables.
Les ateliers en milieu étudiant, menés par des diététicien·ne·s et psychologues, donnent des repères concrets. L’objectif n’est pas de moraliser, mais d’outiller.
Repenser les soirées et les normes
- Proposer de vraies alternatives sans alcool, et pas seulement “de l’eau”, aide à réduire la pression.
- Afficher clairement les degrés et les options, inclure des pauses et valoriser des événements sans alcool.
- Instaurer la culture du “non, merci” sans commentaires : pas de pression pour finir son verre.
Soutien psychologique et accompagnement
Quand la drunkorexie s’installe, un suivi psychologique devient essentiel. Thérapies brèves, suivi nutritionnel et groupes de parole aident à reconstruire une relation apaisée au corps, à la nourriture et à l’alcool. Consulter tôt évite la chronicisation des symptômes.
Si l’anxiété, la dépression ou des conduites addictives coexistent, une prise en charge coordonnée est indispensable. Les services de santé universitaire et les médecins généralistes peuvent orienter sans jugement. C’est confidentiel et apporte un réel soulagement. ✅
Enquêter et agir : du campus aux politiques publiques
Documenter le phénomène localement
Une enquête qui combine témoignages d’étudiant·e·s, points de vue des services de santé universitaires et données des associations permettrait de mesurer l’ampleur réelle et d’évaluer l’efficacité des dispositifs existants.
Ce travail mettrait en lumière des angles morts : manque d’alternatives festives, communication floue, horaires des services, coûts. Il guide ensuite des actions ciblées, co-construites avec les premiers concernés.
Réguler la publicité et responsabiliser le marketing
Les messages qui associent minceur, glamour et alcool entretiennent un imaginaire toxique. Réguler ces messages, limiter le ciblage des jeunes et exiger des mentions claires sur les risques — y compris le lien alimentation/alcool — serait cohérent avec la prévention.
Des campagnes publiques, relayées par des influenceur·se·s crédibles, peuvent changer la narration : montrer des modèles de soirées positives, valoriser la diversité corporelle et débanaliser le “compte-calories” autour de l’alcool peut toucher les 18–25 ans.
Politiques universitaires : chartes et formations
Sur les campus, des chartes “soirées responsables” fonctionnent quand elles sont co-écrites avec les associations : présence d’eau et d’aliments salés, alternatives sans alcool attractives, relais vers des numéros d’aide, formation des organisateur·rice·s aux premiers secours et à la prévention.
Former les référent·e·s étudiant·e·s et le personnel à repérer les signaux d’alerte change la donne. Le message est simple : on peut faire la fête, mais pas au prix de sa santé.
La drunkorexie prospère là où la pression sociale sur l’image rencontre une culture de l’alcool peu questionnée. La bonne nouvelle, c’est que des leviers sont à portée de main : s’informer, préparer ses soirées, changer les normes entre ami·e·s et demander de l’aide sans tarder. La fête n’a pas à être un bras de fer avec son propre corps.
Et vous, quelle première action pourriez-vous lancer — au sein de votre groupe d’amis, votre association ou votre campus — pour que boire ne rime plus avec se priver, mais avec s’écouter et se protéger ? ❓